A l’instant même où tu « donnes » la vie, tu « donnes » aussi la mort et par une sorte de réflexe inconscient, tu te défends de ne jamais associer ces deux cadeaux, même dans tes pensées. Oui, tu vas transmettre à ton enfant un certain nombre de possibilités qu’il pourra développer pour « faire sa vie » avec ce que cette expression a de présomptueux. « Qu’as-tu que tu n’aies reçu ? » 1Cor4,7. Les chantres de la force, de l’autonomie, de la puissance, de la suffisance tomberont d’autant plus bas et violemment que l’hubris, la démesure, les aura propulsés plus haut.
Mystère de la vie associée congénitalement à la mort ! Mais alors : « Qu’est-ce que vivre pour un être humain? »
Il faut distinguer tout d’abord la vie et les modalités de la vie qui répondent aux fonctions primaires : produire et consommer (pour entretenir le vivant), se reproduire, se reposer pour pouvoir recommencer. C’est ce que font, tous les jours, les bovins et les ovins de mes voisins sous mes yeux. L’être humain, n’étant pas encadré par un instinct impératif mais plutôt animé par un désir d’infini, ne met pas de bornes à ses besoins vitaux et finit par étouffer la vie sous le développement exponentiel de ses modalités. Ainsi l’avoir, le pouvoir, le savoir, la recherche de reconnaissance ou de gloire peuvent prendre tout le champ de son existence. Résultat : une course épuisante aux expériences toujours plus nombreuses et plus excitantes accompagnée d’une sorte de nivellement général d’une population d’automates répondant aux mêmes critères et aux mêmes diktats des influenceurs. Le tout sous-tendu par une violence larvée car la concurrence est rude et les moyens de l’affronter illimités. Cette analyse, certes trop caricaturale, accentue le négatif et écrase le positif, mais, au bout du compte, c’est bien une société humaine morose, en mal-être permanent, encombrée de ses propres productions jusqu’à l’épuisement qui se profile: « Ce n’est pas une vie ! Alors prenons les bons moments quand ils se présentent et profitons-en sans scrupule !»
Comment répondre à la question posée, à savoir : « qu’est-ce vivre pour un être humain ? » si nous oublions le mot : « être » ? D’ailleurs, n’est-il pas significatif que Dieu lui-même se soit présenté à Moïse par cette affirmation : « Je suis » ? Avides d’images à notre portée, nous avons habillé ce verbe par toutes sortes de « puissances » qui nous parlent davantage. Mais « être d’abord » n’est-il pas « la raison d’être » de la vie ?
Et si celle-ci n’était pas dans l’accumulation de ses potentialités mais dans l’accueil de cette façon d’être qui m’est originelle, inappropriable, et que je peux appeler mon âme ? Cette trace en creux laissée par Dieu en moi qui m’ouvre sur le « Je suis ». Autrement dit, le premier travail de l’humain ne consiste-t-il pas à faire le vide de tout ce qui ne lui est pas indispensable et à réduire ses « appétits » qui « pompent » son être jusqu’à l’épuiser ? Tous les grands mystiques sont entrés dans cette voie du « délaissement », de « l’abandon de soi », du « vide consenti ». Toutes les règles religieuses ont essayé de l’ordonner et de la baliser pour en proposer une juste modération à ceux et celles qui se sentaient attirés par cette démarche d’être.
Notre grande affaire n’est-elle pas celle de conduire notre vie dans un constant abandon de soi puisque nous ne pouvons pas vivre sans en même temps mourir ? De décrocher de notre personnage de représentation trop encombré de notre image pour laisser se dessiner l’espace de notre être propre, de notre « je » ? Lorsqu’au terme de notre carême terrestre, nous aurons fait coïncider notre vie à notre façon d’être personnelle, lorsque nous aurons trouvé notre « je » original, qui pourra s’inscrire à sa place prévue depuis la fondation du monde, peut-être, alors, mort et vie réconciliées se donneront la main dans l’acte final de notre résurrection éternelle !

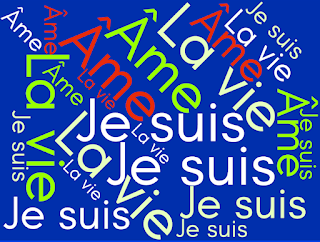


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire